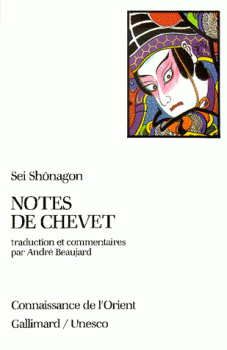Je reviens encore dans le labyrinthe, inexorablement. Je distingue subjectivement (je souligne ce mot pour les googleurs qui seraient ici pour faire un exposé car ici tout est subjectif et rien ne se rattache à une quelconque réalité universelle) trois types de labyrinthes, ce qui engendrent trois façons différentes d’être présent dans le labyrinthe.
1. Le pont labyrinthique : celui que l’on traverse.
 Ce labyrinthe a classiquement une entrée, des couloirs linéaires ou maniérés et une sortie qu’il faut trouver. On peut y être enfermé contre son gré (punition, épreuve, hasard, etc.) ou y être entré volontairement (curiosité, orgueil, ambition héroïque, etc.). C’est le schéma classique, celui de Thésée, de Dédale et Icare ou de ces jardins labyrinthiques qui offrent aux badauds quelques heures d’errance. Les moyens pour se sortir de là ne manquent pas : fil d’Ariane, ailes d’Icare, déductions (topo-)logiques, intuitions, plans, gps, etc. Il s’agit ici de relier, rallier deux points séparés d’obstacles comme on franchirait un pont tortueux surplombant des eaux infranchissables autrement. On peut s’en trouver enrichi par l’épreuve (connaissance, expérience) ou au contraire amoindri par la perte d’un morceau de soi (fatigue, émotion, etc.). Il y a bien l’idée d’un apprentissage, d’une initiation, mais celle-ci peut être fugace et vaine car évacuée dés la sortie car elle n’était pas l’objectif principal de la traversée mais une juste conséquence fortuite. On peut apprendre beaucoup des voyages mais tout oublier une fois son fauteuil retrouvé. Je ne m’étendrais pas sur ce type de labyrinthe largement répandu.
Ce labyrinthe a classiquement une entrée, des couloirs linéaires ou maniérés et une sortie qu’il faut trouver. On peut y être enfermé contre son gré (punition, épreuve, hasard, etc.) ou y être entré volontairement (curiosité, orgueil, ambition héroïque, etc.). C’est le schéma classique, celui de Thésée, de Dédale et Icare ou de ces jardins labyrinthiques qui offrent aux badauds quelques heures d’errance. Les moyens pour se sortir de là ne manquent pas : fil d’Ariane, ailes d’Icare, déductions (topo-)logiques, intuitions, plans, gps, etc. Il s’agit ici de relier, rallier deux points séparés d’obstacles comme on franchirait un pont tortueux surplombant des eaux infranchissables autrement. On peut s’en trouver enrichi par l’épreuve (connaissance, expérience) ou au contraire amoindri par la perte d’un morceau de soi (fatigue, émotion, etc.). Il y a bien l’idée d’un apprentissage, d’une initiation, mais celle-ci peut être fugace et vaine car évacuée dés la sortie car elle n’était pas l’objectif principal de la traversée mais une juste conséquence fortuite. On peut apprendre beaucoup des voyages mais tout oublier une fois son fauteuil retrouvé. Je ne m’étendrais pas sur ce type de labyrinthe largement répandu.
2. Le labyrinthe concentrique : celui dont on cherche le centre.
 Celui-là n’a qu’une entrée et un centre ostentatoire ou ésotérique. Il n’est pas forcément circulaire et son centre peut bien sûr être géométriquement décentré. On n’y entre que volontairement, poussé par un sentiment d’une impérieuse mission. C’est le lieu d’une quête, celle de découvrir un centre qui contient un trésor matériel mais plus souvent spirituel. Un exemple de ce labyrinthe est la réappropriation chrétienne de cet édifice païen qui à l’origine n’est même pas cité dans la Bible (ou si peu) : les labyrinthes des cathédrales proposent ainsi symboliquement un chemin spirituel pour atteindre la foi, Dieu, le Paradis, enfin un nirvana qui vaut le coup de se donner la peine de cheminer. Le plus souvent le chemin proposé, comme un jeu de l’oie, est jonché d’obstacles ou d’étapes censées nous donner la force d’avancer ou la faiblesse de chuter.
Celui-là n’a qu’une entrée et un centre ostentatoire ou ésotérique. Il n’est pas forcément circulaire et son centre peut bien sûr être géométriquement décentré. On n’y entre que volontairement, poussé par un sentiment d’une impérieuse mission. C’est le lieu d’une quête, celle de découvrir un centre qui contient un trésor matériel mais plus souvent spirituel. Un exemple de ce labyrinthe est la réappropriation chrétienne de cet édifice païen qui à l’origine n’est même pas cité dans la Bible (ou si peu) : les labyrinthes des cathédrales proposent ainsi symboliquement un chemin spirituel pour atteindre la foi, Dieu, le Paradis, enfin un nirvana qui vaut le coup de se donner la peine de cheminer. Le plus souvent le chemin proposé, comme un jeu de l’oie, est jonché d’obstacles ou d’étapes censées nous donner la force d’avancer ou la faiblesse de chuter.
 J’ouvre une parenthèse mythologique afin de ne pas « m’enfermer » dans le labyrinthe chrétien : si on devait imaginer Ulysse prisonnier dans sa labyrinthique Odyssée, ce serait celui-ci le modèle. Le dédale « dessiné » par Poséidon afin qu’Ulysse ne rentre jamais au foyer est un labyrinthe concentrique. Ithaque et Pénélope ne symbolise pas la « sortie », l’« issue » du labyrinthe – les issues possibles seraient plutôt le lotos, les sirènes, Circé, etc., les obstacles qui offrent à Ulysse la possibilité de renoncer à poursuivre son chemin et par là à sortir de sa propre histoire d’homme moderne. Non! Ithaque et Pénélope sont bien le centre, le foyer, la matrice et le cœur qu’Ulysse doit retrouver pour recouvrer son intégrité (d’homme désiré, de gouverneur d’Ithaque, de héros rentrant de Troie, etc.). Et réciproquement, car il y a une complémentarité complexe qui unit le chercheur et le cherché : en effet il faut toujours que ce centre recherché se réaffirme en tant que centre désiré. Il faut que Pénélope défende sa position de centre désiré (et menacé) pour maintenir en équilibre l’architecture du labyrinthe. Qu’elle cède à ses prétendants, qu’Ulysse l’apprenne et le labyrinthe n’est plus, ou plus le même, l’histoire également. En cela, le désir est un carburant essentiel de la mécanique labyrinthique, désir de trouver et désir d’être trouvé : ce jeu de cache-cache entretient sans cesse, par l’alternance du voilé/dévoilé, une dynamique amoureuse et érotique qui meut ces deux centres. Cette dynamique, il me semble, nous la ressentons fortement lorsque nous lisons ou écrivons.
J’ouvre une parenthèse mythologique afin de ne pas « m’enfermer » dans le labyrinthe chrétien : si on devait imaginer Ulysse prisonnier dans sa labyrinthique Odyssée, ce serait celui-ci le modèle. Le dédale « dessiné » par Poséidon afin qu’Ulysse ne rentre jamais au foyer est un labyrinthe concentrique. Ithaque et Pénélope ne symbolise pas la « sortie », l’« issue » du labyrinthe – les issues possibles seraient plutôt le lotos, les sirènes, Circé, etc., les obstacles qui offrent à Ulysse la possibilité de renoncer à poursuivre son chemin et par là à sortir de sa propre histoire d’homme moderne. Non! Ithaque et Pénélope sont bien le centre, le foyer, la matrice et le cœur qu’Ulysse doit retrouver pour recouvrer son intégrité (d’homme désiré, de gouverneur d’Ithaque, de héros rentrant de Troie, etc.). Et réciproquement, car il y a une complémentarité complexe qui unit le chercheur et le cherché : en effet il faut toujours que ce centre recherché se réaffirme en tant que centre désiré. Il faut que Pénélope défende sa position de centre désiré (et menacé) pour maintenir en équilibre l’architecture du labyrinthe. Qu’elle cède à ses prétendants, qu’Ulysse l’apprenne et le labyrinthe n’est plus, ou plus le même, l’histoire également. En cela, le désir est un carburant essentiel de la mécanique labyrinthique, désir de trouver et désir d’être trouvé : ce jeu de cache-cache entretient sans cesse, par l’alternance du voilé/dévoilé, une dynamique amoureuse et érotique qui meut ces deux centres. Cette dynamique, il me semble, nous la ressentons fortement lorsque nous lisons ou écrivons.
Ce centre est intangible et insubstituable pour le chercheur. Lorsque ce centre est atteint, s’il est accessible, soit le labyrinthe disparaît comme par magie, comme s’il n’avait jamais existé (fusion en son centre) soit au contraire le labyrinthe devient le décor naturel de ce centre retrouvé, dans lequel le sujet chercheur ne déambule plus (harmonie).
3. Le labyrinthe infini
 La dernière façon d’être dans un labyrinthe est moins accessible car elle ne fait aucunement référence à une réalité concrète ou physique. Ce labyrinthe, on sait qu’il n’y a ni centre (ou tellement qu’on ne peut plus parler de centre), ni sortie, ni rien. On erre dans ces couloirs de la même façon que Sisyphe remonte sa pierre en haut de la colline, indéfiniment. L’errance prend alors un tout autre sens : il n’y pas de but au voyage, seulement notre cheminement absurde et incessant et nos gesticulations pour faire croire que l’on cherche toujours la sortie. Elle peut avoir toutes sortes de conséquences : la folie, pour peu que l’on espère toujours à une issue possible, que l’on cherche à se débattre comme une mouche obstinée contre la vitre ; l’usure par la répétition ad nauseam qui provoque le lent dessèchement de notre matière vivante et puis, évidemment, la mort. Celle que le temps finit par prendre sous le regard désespéré du chercheur ou celle que l’on se donne parce qu’on a plus le courage de battre le pavé de ces couloirs interminables. Il y a fort heureusement une autre manière d’aborder ce type de labyrinthe. J’ai évoqué récemment le Mythe de Sisyphe d’Albert Camus non sans arrière-pensée. Je trouve que cette œuvre, qui s’inscrit pourtant dans la mouvance de l’existentialisme, n’a finalement pas pris de rides au regard de ce courant philosophique d’après-guerre. Elle traite de l’absurdité du sujet face à l’absurdité du monde et des « postures » qu’il peut prendre face à elle. Il écarte rapidement le suicide philosophique qu’il juge comme une solution infructueuse. Puis il essaye d’imaginer Sisyphe heureux car finalement « maître de ses jours », de son destin. Il n’y a pas de sortie au labyrinthe, certes, mais le cheminement et l’errance infinie qui nous poussent à toujours avancer est source de bonheur, car c’est une révolte et une lutte permanente pour se définir comme chercheur libre dans un labyrinthe absurde et infini. Une fois inscrit dans ce processus labyrinthique, le chercheur peut éprouver le besoin de rester à l’intérieur de celui. De peur qu’il ne trouve une sortie (sait-on jamais !) il va alors construire lui-même les murs et les couloirs sinueux afin de devenir l’architecte de son errance, de sa révolte et de son bonheur infini. Il me semble que ce labyrinthe est celui que recherchent les créateurs de toutes sortes car c’est celui qui, à mon avis, est le plus fertile, le plus apte à pousser le créateur à comprendre, à imaginer, à concevoir, à bâtir du vide dans le vide du labyrinthe et à l’en rendre heureux.
La dernière façon d’être dans un labyrinthe est moins accessible car elle ne fait aucunement référence à une réalité concrète ou physique. Ce labyrinthe, on sait qu’il n’y a ni centre (ou tellement qu’on ne peut plus parler de centre), ni sortie, ni rien. On erre dans ces couloirs de la même façon que Sisyphe remonte sa pierre en haut de la colline, indéfiniment. L’errance prend alors un tout autre sens : il n’y pas de but au voyage, seulement notre cheminement absurde et incessant et nos gesticulations pour faire croire que l’on cherche toujours la sortie. Elle peut avoir toutes sortes de conséquences : la folie, pour peu que l’on espère toujours à une issue possible, que l’on cherche à se débattre comme une mouche obstinée contre la vitre ; l’usure par la répétition ad nauseam qui provoque le lent dessèchement de notre matière vivante et puis, évidemment, la mort. Celle que le temps finit par prendre sous le regard désespéré du chercheur ou celle que l’on se donne parce qu’on a plus le courage de battre le pavé de ces couloirs interminables. Il y a fort heureusement une autre manière d’aborder ce type de labyrinthe. J’ai évoqué récemment le Mythe de Sisyphe d’Albert Camus non sans arrière-pensée. Je trouve que cette œuvre, qui s’inscrit pourtant dans la mouvance de l’existentialisme, n’a finalement pas pris de rides au regard de ce courant philosophique d’après-guerre. Elle traite de l’absurdité du sujet face à l’absurdité du monde et des « postures » qu’il peut prendre face à elle. Il écarte rapidement le suicide philosophique qu’il juge comme une solution infructueuse. Puis il essaye d’imaginer Sisyphe heureux car finalement « maître de ses jours », de son destin. Il n’y a pas de sortie au labyrinthe, certes, mais le cheminement et l’errance infinie qui nous poussent à toujours avancer est source de bonheur, car c’est une révolte et une lutte permanente pour se définir comme chercheur libre dans un labyrinthe absurde et infini. Une fois inscrit dans ce processus labyrinthique, le chercheur peut éprouver le besoin de rester à l’intérieur de celui. De peur qu’il ne trouve une sortie (sait-on jamais !) il va alors construire lui-même les murs et les couloirs sinueux afin de devenir l’architecte de son errance, de sa révolte et de son bonheur infini. Il me semble que ce labyrinthe est celui que recherchent les créateurs de toutes sortes car c’est celui qui, à mon avis, est le plus fertile, le plus apte à pousser le créateur à comprendre, à imaginer, à concevoir, à bâtir du vide dans le vide du labyrinthe et à l’en rendre heureux.
Ces trois postures dans le labyrinthe ne sont pas figées, loin de là, et on peut imaginer sans peine qu’un sujet commence par rentrer dans un labyrinthe qu’il se doit de traverser. En chemin, il s’aperçoit que quelque chose l’attire à l’intérieur même sur labyrinthe, il se détourne de la sortie et en cherche alors ce centre, cet objet du désir. Oui mais voilà, ce centre n’est pas fixe, il bouge sans arrêt – comme cette farce de clown où le chapeau tombé par terre s’éloigne dés qu’il veut l’attraper – et le chercheur poursuit sa quête, inlassablement.
Pourquoi, me direz vous, cette réflexion sur le labyrinthe ? Je trouve qu’il est intéressant de regarder les choses (le monde, l’homme, l’art, etc.) sous un angle toujours nouveau, qu’à toujours considérer les choses pour ce qu’elles sont on les use, on les appauvrit de leur substance, ou plutôt non ! On use et on appauvrit notre regard quotidien sur elles.
Il ne s’agit pas évidemment de didactisme, de philosophie ou d’encyclopédie, simplement de rêveries (au sens où Bachelard entend ce mot) afin de m’ouvrir une pluralité des sens de notre monde absurde.
J’ai opté ici pour le labyrinthe mais j’aurais pu faire pareil avec tout autre chose : le sommeil, la route, la maison…
A suivre probablement…
Ecrire en marge
 Écrites par Sei Shônagon il y a un peu plus de mille ans, ces Notes de chevets (appelées parfois également Notes de l’oreiller), ces sôshi sont les écrits intimes, le journal quotidien de cette dame d’honneur au service d’une princesse. C’est une lecture étonnante mais savoureuse qu’il est préférable de prendre par petites bouchées, comme des gourmandises. Et puis y revenir. On y découvre un inventaire gigantesque, ordonnancé mais pas classé et inversement. Il n’y pas aucun plan, aucune volonté de marteler un message, elle peut émettre un jugement moral, mais n’en fera pas une règle générale (comme le feront nos moralistes, La Bruyère, Sévigné, avec lesquels on peut cependant trouver quelques similitudes). Elle explore, parfois en se répétant. Elle décrit le monde comme il vient, en suivant ses humeurs : tel mot lui rappelle une anecdote et le récit dérive emporté par cette vague et le ressac nous ramène au point de départ. Cela donne l’impression d’une écriture qui digresse sans cesse tout en restant principalement centrée sur l’intimité de sa narratrice, sur ce qu’elle ressent, ce qu’elle juge, soupèse… On y trouve également beaucoup de tableaux très vivants du Japon de l’an mil, des chevaliers, des femmes, des vieux, des enfants, plein de petites scènes qui se rejouent sous nos yeux.
Écrites par Sei Shônagon il y a un peu plus de mille ans, ces Notes de chevets (appelées parfois également Notes de l’oreiller), ces sôshi sont les écrits intimes, le journal quotidien de cette dame d’honneur au service d’une princesse. C’est une lecture étonnante mais savoureuse qu’il est préférable de prendre par petites bouchées, comme des gourmandises. Et puis y revenir. On y découvre un inventaire gigantesque, ordonnancé mais pas classé et inversement. Il n’y pas aucun plan, aucune volonté de marteler un message, elle peut émettre un jugement moral, mais n’en fera pas une règle générale (comme le feront nos moralistes, La Bruyère, Sévigné, avec lesquels on peut cependant trouver quelques similitudes). Elle explore, parfois en se répétant. Elle décrit le monde comme il vient, en suivant ses humeurs : tel mot lui rappelle une anecdote et le récit dérive emporté par cette vague et le ressac nous ramène au point de départ. Cela donne l’impression d’une écriture qui digresse sans cesse tout en restant principalement centrée sur l’intimité de sa narratrice, sur ce qu’elle ressent, ce qu’elle juge, soupèse… On y trouve également beaucoup de tableaux très vivants du Japon de l’an mil, des chevaliers, des femmes, des vieux, des enfants, plein de petites scènes qui se rejouent sous nos yeux.